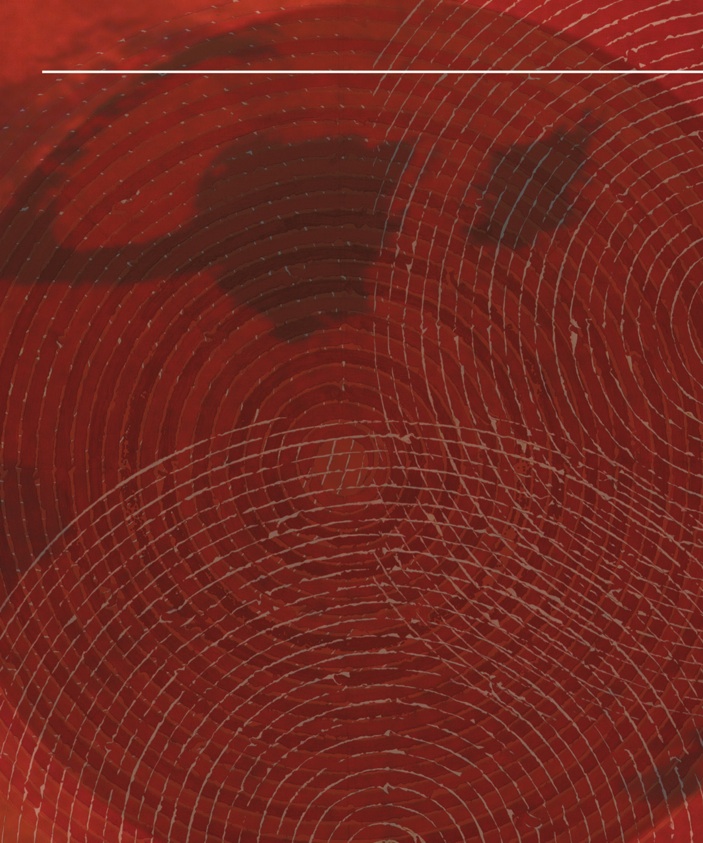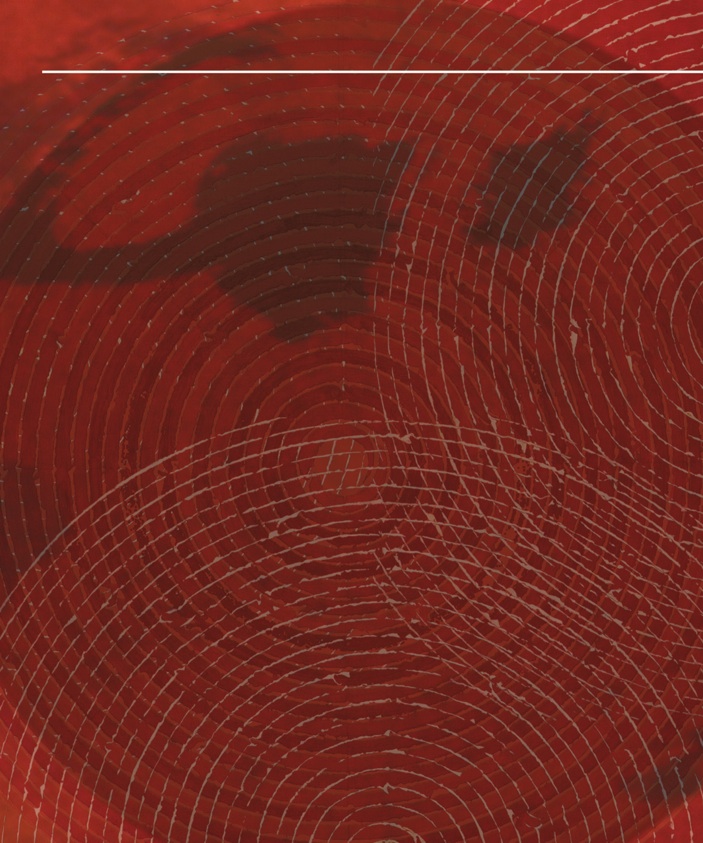" La situation française est unique par les liens des fournisseurs de l'État et la presse... il ne s'agit plus comme par le passé de l'influence d'éventuels annonceurs. Il s'agit d'industriels qui, par leurs connexions avec l'État, créent un puissant réseau de relations bilatérales et de liens mutuels. "
André Schiffrin Le contrôle de la parole Éditions La Fabrique
En écrivant Le contrôle de la parole, André Schiffrin, éditeur américain, dresse un tableau inquiétant de l’évolution de l’édition en France. François Maspero a rendu compte de ce livre : « … Le monde de l'édition comme celui de la presse, c'est-à-dire tout le marché des idées et de l’information écrites en France, est désormais entre les mains de groupes dont les intérêts majeurs vont de la fabrication et la vente d’armes à celle des cosmétiques (Lagardère, Rothschild, Dassault…) ce qui n’a pas grand-chose à voir avec la vie intellectuelle. Et si l’on ajoute encore le poids du groupe Bouygues dans le secteur de l’audiovisuel, dont le fleuron est TF1, on ne peut que donner raison à André Schiffrin rappelant que Berlusconi a bâti son empire sur les médias, que Chirac a été à ses débuts largement sponsorisé par Dassault… La prise de contrôle par des investisseurs de cet ordre change radicalement la vision qu’un éditeur pouvait avoir de la rentabilité : là où beaucoup trouvaient honorable, voire remarquable, d’obtenir des bénéfices de 4 %, là où Editis avait réussi à atteindre les 10 % à force d’économies d’échelles, « ces fonds, qu’ils soient américains ou français, suivent tous la même voie, leur principale caractéristique est qu’il s s’attendent à un retour sur investissement de 25 %, et ce dès la première année. (...) Dans certains cas, ils vont jusqu’à demander 40 % » comme l’expliquait Le Monde du 11 août 2004. L’effet d’une telle exigence de rentabilité, M. de la Martinière le résumait parfaitement par une formule dix jours après son rachat du Seuil : « Il n’y a pas de honte à être rentable sur chaque titre ». Peut-être, mais si l’on retranchait du catalogue du Seuil tous les titres qui n’ont pas été rentables, on l’amputerait d’une bonne partie des auteurs qui ont fait sa renommée et sa richesse. D’abord parce que nombreux sont les auteurs qui ne sont devenus rentables qu’au troisième ou au quatrième livre, lesquels n’auraient donc pu voir le jour. Et peut-être aussi parce que, même vendus au-dessous du seuil de rentabilité, ils peuvent avoir une autre valeur, non chiffrable immédiatement en euros…Ce qui fait que si ces titres-là n’avaient pas existé, tout déficitaires qu’ils aient pu être, le Seuil n’aurait pas été l’éditeur prestigieux qu’il a été et M. de la Martinière n’aurait probablement éprouvé aucun intérêt à l’acheter… La révolution technologique qui est intervenue dans l’édition depuis vingt ans a permis, il est vrai, de raccourcir prodigieusement le processus de mise sur le marché d’un livre : désormais l’auteur,en livrant son texte par internet, livre la composition toute faite. S’il est heureusement toujours des éditeurs qui possèdent de remarquables services de préparation (et le Seuil en fait partie), on en voit certains qui envoient aux auteurs des « épreuves » où ceux-ci retrouvent ce qu’ils ont tapé à la virgule près, coquilles et fautes de frappe comprises.
LA DÉMOCRATIE EN DANGER
À tel point qu’on en arrive à se demander si, dans ce circuit raccourci, quelqu’un a pris la peine de lire le texte. Ce qui serait l’application à la lettre d’une « édition sans éditeurs », pour reprendre le titre du précédent livre de Schiffrin. La recherche du « coup » à tout prix conduit en tout cas à la prolifération de produits bâclés : « Pour publier des photos de chats et de la famille royale, pas besoin d’être éditeur ». Qu’importe, puisque le complexe du groupe qui intègre tous les médias, télévision, presse est là pour assurer la promotion ! Le secteur à coup sûr rentable du circuit éditorial est la distribution. Il importe donc de le mettre à l’abri. André Schiffrin prend pour exemple la décision immédiate de La Martinière de séparer l’activité d’éditeur du Seuil de son activité de distributeur, en procédant à un « changement crucial pour l’équilibre financier de la maison » par la création d’une société séparée, Volumen. Ce qui avait été une source majeure de revenus soutenant les efforts éditoriaux de la maison devenait un centre de profit indépendant. C’est là une manœuvre classique des conglomérats (…) On met une pression énorme sur le secteur éditorial une fois privé de son support le plus rentable. Peut-on échapper au contrôle de cette version « post-moderne » de Big Brother ? Un paradoxe est qu’il existe aujourd’hui une myriade de petites maisons indépendantes, grâce notamment à la simplification du processus de fabrication d’un livre. Beaucoup, telles que Aube, Verdier, Climats, La Fosse aux Ours (en province), Maurice Nadeau, Syllepse, La Fabrique, José Corti, Vatelier (à Paris), Complexe (en Belgique) et bien d’autres dont la liste remplirait plusieurs pages de La Quinzaine, si elles n’ont guère de poids économique, ont un réel poids intellectuel…
On souhaite qu’un effort de concertation pour une action coordonnée soit en cours. On souhaite a ussi que les auteurs, qui ne se sont guère fait entendre sur ce chapitre, s’expriment davantage. C’est vrai aussi qu’ils n’ont jamais été consultés. Après tout, sont-ils considérés autrement dans cette histoire que des « collaborateurs extérieurs »? Mais ce n’est pas une raison pour se taire, au contraire ! L’une des solutions que met en avant André Schiffrin, fondée sur sa propre expérience, est justement la création de sociétés à but non lucratif, au financement desquelles participeraient les auteurs, à l’exemple de ses propres « New Press ». Il cite aussi Ordfront en Suède qui repose sur une coopérative de lecteurs : « Quelques 30 000 personnes qui payent chaque année une somme modique (...) Si 10% seulement achètent un titre, Ordfront est à l’équilibre (…) ». Utopie peut-être. Mais sinon, la situation actuelle risque bien de déboucher sur cette alternative : ou bien les nouveaux investisseurs parviendront à la rentabilité qu’ils escomptent, et c’est le déclin assuré, la stérilisation, voire la disparition de l’indépendance de presque tout ce qui s’écrit et se publie en France ; ou bien ils y échoueront et pas fous, ils retireront leur mise pour la réinvestir dans des secteurs plus rentables (les OGM, par exemple). Il ne nous restera plus alors qu’à contempler le paysage après la défaite et à nous demander comment recoller les morceaux, si tant est que ce soit possible ».
François Maspero Extraits de «Main basse sur l’édition»
La quinzaine littéraire 16-04-2005